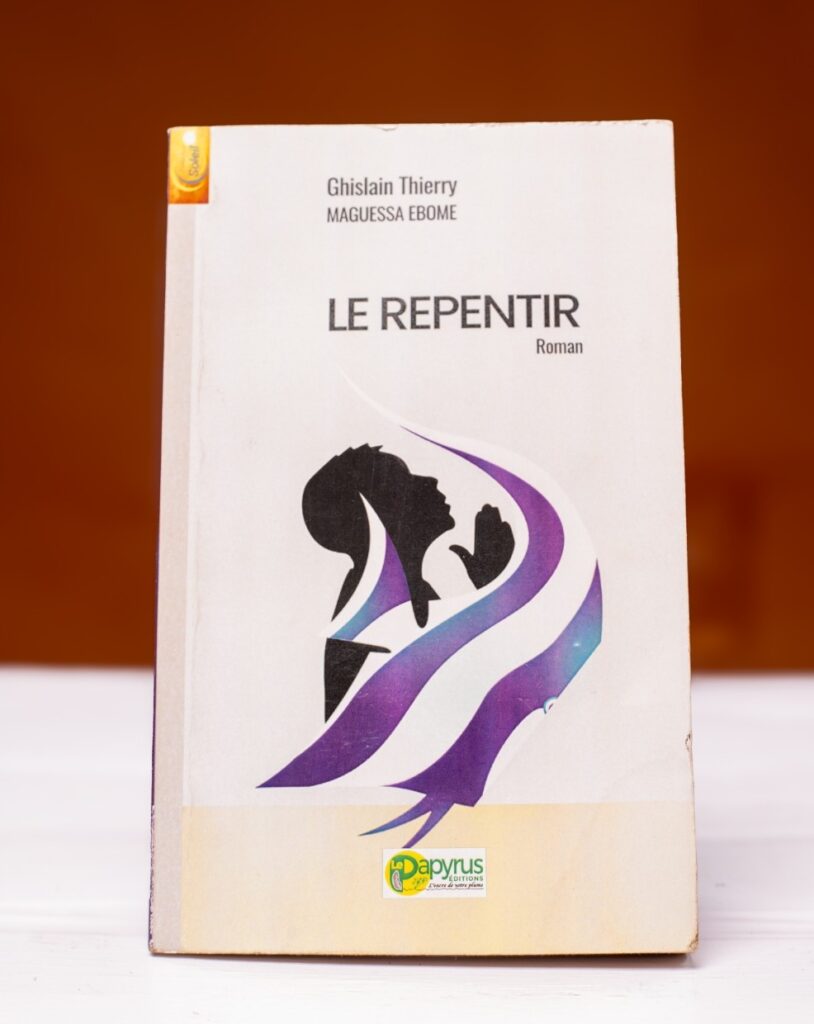Dans son roman au titre sus-évoqué, l’auteur Maguessa Ebome raconte une des innombrables tristes histoires qui ont jalonné la guerre des milices au Congo, notamment dans la région du Pool. Il s’agit de l’histoire d’un ex-membre de la milice des Ninjas, Sardine, qui a assassiné dans le feu de la furie des tueries inter tribales le jeune élève Gilbeau (dont il a jalousement conservé la carte scolaire, soit comme trophée, soit comme relique, soit comme instrument de ce qui pouvait lui rester au moment de son acte comme conscience humaine), frère de Beljamie, petite amie du narrateur André Eboko en dépit de leurs différences tribales et régionales, se repent de l’acte jadis posé, avec l’accompagnement du narrateur, et sollicite le pardon de la famille du défunt, la famille Malonga. Cette dernière le lui accorde, convaincue de sa sincérité, arc-boutée sur sa foi chrétienne qui accule au pardon, et peu désireuse de poursuivre la logique de la belligérance fratricide.

Claudette Chancelle Marie-Paule BILAMPASSI MOUTSATSI
Au cœur de cette histoire probablement trop idyllique, une problématique de fond : l’intelligence du pardon, vecteur d’une réconciliation durable dans une société hantée par un passé récent violent et traumatisant. Pour développer cette thématique, un certain nombre d’entrées sont à retenir.
Que peut-on pardonner ? Presque tout, y compris la mort atroce et injuste d’un être cher et innocent, victime d’une violence aveugle, gratuite et sans but défendable par une conscience éclairée.
Qui peut-on pardonner ? Le pardon peut-il être donné sans objectiver les auteurs des crimes, sans mettre un visage humain à la catastrophe mortifère, et se rendre compte ce faisant que si l’auteur de l’acte est comme soi-même, il n’est pas exclu que l’on ait pu ou que l’on puisse un jour agir ou réagir comme lui, face aux mêmes incitations ou manipulations belligènes ? Le pardon peut-il être accordé à celui qui ne reconnaît pas son crime ? Le repentir sincère et explicite à l’offensé et à ses ayants-droits est le fondement du pardon, la base d’une « culpabilité transformatrice » (p.24).
Pourquoi pardonner ? Parce que le criminel l’est souvent « malgré lui », involontairement, parce que manipulé et victime lui-même d’un système violent, injuste et producteur de frustrations, de logiques criminelles et débilitantes, comme c’est en partie le cas de Sardine, diplômé de l’enseignement supérieur frustré par « le système » et « rejeté » pour se débrouiller dans son village. Même ceux que l’on croit éclairés ou un peu éveillés peuvent sombrer dans la violence obscure. Le criminel est une victime, et il importe de « sauver une âme étranglée » (p.75). Il faut pardonner parce que la logique de vengeance crée un cercle vicieux de la violence et de la contre violence. Le pardon offre une chance de « reconquérir l’humanité sournoise en chaque criminel » (p.25). Il faut donner une nouvelle chance à une personne qui s’est égarée, et apprendre selon le beau titre du livre d’Isabelle Le Bourgeois, à Vivre avec l’iréparé. Le pardon libère celui qui pardonne des « démons de la « velléité vengeresse » (p.10), de « la logique de la réciprocité du sang à verser pour que noble réparation soit consentie» (p.11) pour du sang versé auparavant. Face au repentir, le refus de pardonner peut prendre les allures d’une forme de contre violence similaire à la violence condamnée.
« L’intelligence du pardon, vecteur de réconciliation durable dans une société traumatisée par un violent conflit fratricide «
Comment organiser le pardon ? Le pardon et la réconciliation ne s’imposent et ne s’improvisent pas. Ils doivent être organisés, préparés et conduits méthodiquement. L’on doit préparer les esprits, le terrain, le cadre, le moment, par l’action des personnes médiatrices jouissant auprès des protagonistes d’un minimum de crédit, et même de crédibilité et de confiance. On mène les choses de manière à arriver au stade où la communauté assemblée pour recevoir le repentir, crie d’un élan spontané « NOOON » (p.72) à l’idée d’infliger la mort de sang froid pour venger une mort infligée injustement et inutilement sous l’emprise de passions mortifères. Arriver à ce stade où le corps social dit « PLUS JAMAIS CELA » est probablement le signe d’un processus de pardon réel et de réconciliation assuré d’être durable.
Le pardon est un chemin sacrificiel sur lequel toutes les bonnes volontés comptent, et pas seulement les actions des autorités publiques. La réconciliation est un processus de libération collective du mal de la méfiance, de la vengeance, des clivages tribaux et régionaux entretenus par les politiques, pour le vivre ensemble harmonieux.
Claudette Chancelle Marie-Paule BILAMPASSI MOUTSATSI